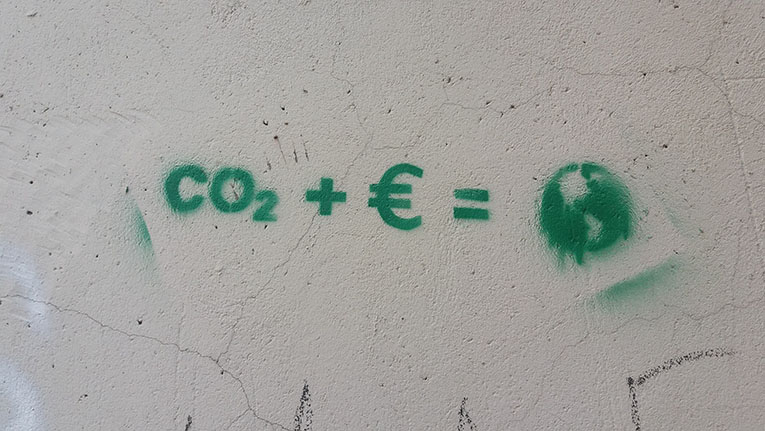Peut-on imaginer un monde économique sans croissance ? Au niveau de la pensée économique, certaines voix soulignent que l’idée de croissance économique ne peut plus être crédible en raison du lien entre croissance et dérèglement climatique. L’économiste Mireille Bruyère, professeur à l’université Toulouse-2, membre du collectif Les Économistes Atterrés, défend dans un grand entretien accordé à Feat-Y le concept de « décroissance productive », impliquant une refonte profonde du mode de production car pour elle, la production est au cœur du capitalisme et vouloir modifier le mode de consommation est insuffisant face aux défis du changement climatique. Interview.
Feat-Y : Quel regard portez-vous sur la COP26 qui s’est déroulée en novembre dernier ?
Mireille Bruyère : C’est un échec. Depuis la COP21 et l’accord de Paris qui a été présenté comme une réussite parce qu’il y a eu un accord, des engagements, on a vu que ces engagements n’ont pas du tout été tenus. Et plus on attend, plus les « efforts à faire seront importants ». Il faudrait que les Etats s’engagent de manière très concrète, très rapidement sur les choses qui étaient déclarées à la COP de Paris.
Feat-Y : Est-ce qu’une réorientation de l’épargne, de l’investissement, vers des projets décarbonés, éco-responsables est possible selon vous ? Si oui, par quels moyens ?
M.B : La transition, la bifurcation productive va demander une orientation différente des flux d’investissement. C’est une évidence. La question est qu’il ne suffit pas simplement de défiscaliser et ainsi de laisser en l’état le système actuel de financement. On a besoin d’une politique plus ambitieuse, mais aussi peut-être plus coercitive concernant les investissements, comme interdire par exemple immédiatement les investissements dans les énergies fossiles. Ça demande un contrôle plus grand des banques qui tiennent actuellement un double discours, à savoir qu’elles disent s’engager dans la transition écologique, dans la croissance verte, mais en même temps, elles continuent de soutenir des entreprises exploitant des énergies fossiles en espérant qu’un investissement dans un projet écologique mineur occultera les investissements colossaux dans les énergies fossiles.
Il faudrait démanteler les grandes banques. Dans un premier temps les mettre sous tutelle, temporairement nationale, avec l’hypothèse de soutenir une orientation plus écologique. Ça demande un changement politique majeur. Il faudrait réorienter leur finalité, en direction des territoires, pour qu’elles refassent un travail de financement bancaire en connaissance de l’écosystème des territoires, pour financer des investissements, par exemple, dans le parc éolien issu d’initiatives citoyennes. Une politique de financement beaucoup plus décentralisée et territorialisée car actuellement, on ne voit pas comment, avec ce système bancaire et les marchés financiers, axé sur la recherche du profit, de la rentabilité, on peut arriver à une bifurcation productive. Il faut ajouter aussi que la question des investissements et de l’épargne n’est pas suffisante. Il n’y a pas que l’épargne qui peut financer la bifurcation productive. Il y a également le système de crédit, c’est-à-dire la création monétaire. Le rôle d’un système bancaire socialisé et réorienté vers les territoires, serait ainsi de financer cette bifurcation.
Mais il faudrait également des financements pour démanteler certaines activités qui doivent s’arrêter, et non pas être transformées. Je prends souvent l’exemple d’Airbus. La bifurcation demande que le transport aérien diminue, pour devenir un transport avec des usages plus restreints (familiale ou sanitaire par exemple), et non pas des usages de tourisme de masse par exemple. Cela va demander un démantèlement d’une partie des activités d’Airbus. Il faudra accompagner les travailleurs de ce secteur, à travers de la formation en direction d’activités moins productives. Il faut avoir en tête que la bifurcation demande non seulement une réorientation productive souhaitée par tous, mais aussi et même surtout une réduction d’une partie de cette capacité productive par des opérations démantèlement ou de mise en jachère d’actifs devenus toxiques et dangereux comme une partie des technologies numériques.
Feat-Y : La question sociale, sous l’angle des salaires, est revenue sur le devant de la scène dans le cadre de l’élection présidentielle de l’an prochain. Estimez-vous qu’il faille aller plus loin là-dessus et de l’articuler avec la problématique écologique ?
M.B : C’est évident. La première chose, c’est que la crise écologique a la même origine que de l’augmentation des inégalités, de la précarité, des bas salaires. C’est sur le capitalisme, qui est un rapport social de production dont l’autre face est le consumérisme. Et pour répondre à la fois aux inégalités et à la crise écologique, il suffit de transformer profondément ce rapport social de production qu’est le capitalisme, basé sur la recherche d’accumulation, de profit mais encore plus profondément sur la recherche d’une maitrise technologique totale du monde, de la vie, des autres.
Il y a donc derrière les rapports sociaux institués dans l’économie et par l’économie, une visée plus politique, plus anthropologique, de vouloir toujours développer plus de modes de production, d’outils fortement intégrés, plus puissants, plus efficaces, mais à des coûts écologiques et humains considérables. Il ne s’agit pas de revenir à la bougie, mais il s’agit de pouvoir produire d’une autre manière, en se basant sur d’autres pratiques fondées sur d’autres visées politiques. Des principes reposant sur la capacité qu’ont les travailleurs de pouvoir s’approprier leurs outils de production. Pas seulement en termes de propriété, mais aussi de connaissance. Un mode de production qui va demander, par exemple, que les techniques soient plus décentralisées et moins complexes. C’est-à-dire que la production industrielle, qui se caractérise par des chaînes de valeur mondiales fracturées en petits échelons disséminés sur l’ensemble de la planète, avec des systèmes qui sont très complexes, très intégrés, doit être remise en question pour produire d’une autre manière. On produira toujours les mêmes valeurs d’usage (se loger, s’habiller, se nourrir…). On aura toujours besoin de véhicules pour se déplacer. Il n’est pas question de revenir en arrière. On produira d’une manière plus sociale, qui permet de préserver une forme d’égalité et de démocratie dans le travail et de limiter plus fortement les impacts sur la nature.
Il faut augmenter les bas salaires et en même temps, réduire les hauts salaires. À partir d’un certain seuil, on sait que la responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre est très inégalement répartie et suit avec une très forte corrélation le niveau de revenu. Il n’est pas question d’augmenter les salaires à partir d’un certain seuil. Il faut même les diminuer.
Feat-Y : Jusqu’à présent, certains candidats se sont positionnés sur une ligne pro-nucléaire, arguant que cette énergie est efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique, peu coûteuse économiquement et qu’elle contribue à l’indépendance énergétique de la France. Est-ce bel et bien le cas actuellement, ainsi que dans une perspective de long terme ?
M.B : La question du nucléaire n’est pas uniquement une question économique, même si c’est une production à base d’énergies fossiles, tant il est bon de le rappeler. Les aspects physiques du nucléaire ouvrent à une réflexion de nature philosophique puisqu’on sait qu’un accident nucléaire n’est pas probabilisable. Pour faire un calcul coût/bénéfice en économie, on va calculer les coûts d’une action, d’un engagement par rapport aux avantages que cela procure. Tout cela demande à être quantifié en termes économiques. Et on va mettre en probabilité le risque d’accident. Or, le problème est que les coûts d’un accident nucléaire sont incommensurables. C’est la limite de la mesure. On ne peut pas mesurer, sur le territoire français, l’effet d’un accident nucléaire car il supprimerait beaucoup de vies humaines et rendrait inhabitable pour des milliers d’années une partie du territoire. On a des effets qui sont difficilement mesurables et qui sont que la question du nucléaire ne peut pas être réduite à une question purement économique et énergétique, en termes de transition énergétique.
Il faut une réflexion plus générale de la société. Dans quel type de société nous voulons vivre ? Et à partir de là, nous devons choisir quelle énergie à exploiter. Pour ma part, j’estime qu’une société conviviable, avec de faibles inégalités, sobre au niveau énergétique, ne peut pas être compatible avec le nucléaire car ce n’est pas seulement une énergie, mais aussi un système qui va engager une très forte centralisation. Je crois qu’une appropriation citoyenne minimale de cette énergie, une décentralisation avec petits réacteurs décentralisés, n’est pas possible avec le nucléaire. Pour ma part, je ne souhaite pas que la « transition » énergétique passe essentiellement par le nucléaire pour cette raison politique essentielle qu’il nous faut choisir l’énergie qui ne fractionne (trop) pas la société.
Ensuite, la question de la transition énergétique se pose souvent sous un seul mode. C’est-à-dire, seulement dans le cadre d’un maintien notre niveau de consommation, quitte à relancer temporairement le gaz le temps de trouver des moyens de maintenir ce niveau comme c’est le cas aujourd’hui. Dans ce cadre-là, il n’y a pas beaucoup d’options. On sait que les énergies renouvelables ont pour « inconvénient », notamment aux yeux du capital, d’être intermittentes, discontinues. Comme elles ne peuvent pas, ou très difficilement, relever le défi de produire de manière continue une quantité aussi élevée d’énergie, on voit mal comment faire une transition sans le nucléaire parce que la question est posée dans un seul cadre, celui du capitalisme et de sa nécessaire croissance énergétique.
Il faudrait poser la question en changeant le cadre et dire « quelle société nous voulons ? » et « quel type d’énergie nous voulons ? ». Si on réfléchit à une société plus démocratique et conviviale, relocalisée, avec des systèmes productifs à taille humaine, etc. alors la condition de la baisse de la production d’énergie et la question de l’intermittence peut tout à fait être envisagée. Ça ne signifie pas une perte, un recul, comme on l’entendit dire trop souvent, un retour aux années 50-60. On ne reviendra jamais dans les années 50, c’est un argument de paresseux que de dire cela à ceux qui pensent comme moi qu’il nous faudrait aussi une sobriété énergétique. Même si on fait une bifurcation sous le mode de la sobriété, on produira certainement moins que maintenant mais cela n’aura rien à voir avec les modes de vie des années 60. L’histoire ne revient jamais en arrière tout simplement parce que nous héritons toujours du passé et qu’on ne peut l’oublier (en particulier la masse des connaissances scientifiques seront toujours là). Du fond, il faut souhaiter que ça passe par une grande démocratie, une forte reterritorialisation et une réduction de la taille du système productif.
Feat-Y : En 1972, le Club de Rome sortit son rapport intitulé Les Limites à la croissance, connu sous le nom de « rapport Meadows », du nom des auteurs de ce texte. Est-ce que près de 50 ans plus tard, la science économique a su revoir sa vision du développement économique ou reste-t-elle ancrée dans une sacralisation de la croissance économique à tout prix ?
M.B : J’ai envie de dire qu’à l’intérieur de la science économique, ceux qui se définissent autour de l’école néo-classique, se reposent sur l’idée de la rationalité économique des agents et du progrès de la raison. Dans ce champ de la pensée économique, comme dans la pensée philosophique contemporaine, on fait l’hypothèse d’une augmentation de la raison par la science, d’une accumulation de connaissances chaque année que la rationalité économique est censée rendre compte de ce progrès de la raison. Je pense à une interview, sur France Culture, de Christian Gollier, professeur au Collège de France, qui indique que le travail des économistes est de toujours quantifier des phénomènes, de manière à les faire rentrer dans les calculs coûts/bénéfices et de pouvoir faire des choix. Cette idée de quantification est, pour lui, un progrès en soi parce que ça permet un meilleur éclairage des politiques. C’est complètement fallacieux car cela universalise et naturalise une conception politique de l’être humain défini par sa « rationalité économique » qui est historiquement née avec le capitalisme. La rationalité tout court (on pourrait dire les rationalités) dans la grande histoire humaine ne se réduit pas à la rationalité économique des économistes. Pour ceux-là, quand ils disent : « Il faut que les choses soient rationnelles », il faut donc, pour eux, toujours quantifier. Et plus on quantifie, on quantifie en valeur économique qui est une institution du capitalisme. Plus on quantifie de nouvelles activités, plus la sphère économique augmente. Et donc, plus de croissance économique. C’est ça la phénoménologie de cette pensée, conduisant à avoir une réflexion qui s’inscrit dans la croissance verte. C’est le mode opératoire principal en économie. C’est-à-dire que malgré les alertes à l’extérieur de l’économie sur la limite matérielle, écologique de la planète Terre et du climat social, vu que ça va ensemble, en termes de barbarie j’ai envie de dire, la science économique pense que la solution vient de l’intérieur de l’économie, en rationnalisant toujours plus l’activité économique pour faire cette croissance verte.
Il y a une partie de l’économie, qu’on appelle l’hétérodoxie, pour laquelle la croissance verte est critiquée, globalement. Je constate que dans l’hétérodoxie, on n’appelle plus à la croissance verte d’une manière aussi naïve et on a depuis quelques années une critique de plus en plus forte de la croissance. Cela dit, je constate, à mon grand regret, qu’imaginer la décroissance productive, c’est un tabou absolu dans le champ économique. C’est encore difficile à entendre. On se retrouve dans une forme de discours schizophrène dans lequel un collègue demande une transition, une bifurcation écologique dans le monde industriel, en appelant les industries à produire des biens de consommation plus durables, comme des voitures, sans se rendre compte que si c’est vraiment le cas, on aura une décroissance productive globale. Si on avait une machine à laver qui dure 20 ans ou un frigo qui dure 40 ans, c’est qu’elles sont réparables sur le territoire, donc avoir un réseau d’artisans sur le territoire capables de réparer. C’est plus d’emploi mais aussi une baisse de la productivité horaire globale du secteur. Cela conduit à de la décroissance productive car on utilise moins d’énergie et beaucoup moins de croissance de l’activité économique parce qu’on achète moins. On ralentit la machine. Et ralentir signifie moins de croissance. On produira moins, mais on produira de manière durable. Quand vous équipez des ménages de machines à laver qui durent 30 ans, ça signifie qu’ils vont moins acheter dans les 30 années à venir. Donc, au lieu d’avoir des millions de machines à laver achetées chaque année, on en aura beaucoup moins. C’est de la décroissance productive mais plus d’emploi. On ne va pas les produire. C’est-à-dire que gens qui produisent des machines vont moins produire. La transition pour eux se posera. Une partie de la production devra être réorientée vers la réparation artisanale.
Dans le champ de l’économie, la décroissance productive doit être distinguer de la décroissance économique car cela appelle à des discussions théoriques assez complexes à présenter. Mais ce qui est clair, c’est que la bifurcation écologique demandera de moins produire et de moins consommer. On peut l’appeler sobriété productive de consommation, si vous voulez. Quels seront ses effets sur les prix et les coûts économiques de la matérialité de la production et de la consommation ? C’est un débat très complexe mais qui est suffisamment important, à l’intérieur du champ des économistes. En tout cas, pour éclairer le débat public, il faut se mettre en tête qu’il y aura à moins produire et à moins consommer, mais cela n’aura pas le même impact selon la classe sociale. L’effort devra être plus important pour les plus riches.
Feat-Y : Depuis quelques années, la question de la décroissance se pose et suscite du débat chez les économistes. Comment analysez-vous ce concept de décroissance et estimez-vous qu’il a de la pertinence dans la pensée économique contemporaine, notamment au regard des effets de la crise sanitaire depuis plus d’un an ?
M.B : J’aimerais dire qu’avant la crise sanitaire, il y a eu quand même de plus en plus de questionnements sur la bifurcation écologique, sa signification, auprès du grand public. J’ai remarqué que dans les interviews de la matinale de France Inter, on évoque quelques fois la décroissance alors qu’il y a 10 ans en arrière, c’était complètement tabou, ou du moins très confidentiel et lié aux milieux écologiques très militants, ou aux milieux intellectuels. Il y avait déjà une sensibilité avant la crise sanitaire et cette dernière vient montrer ce que pourrait être une décroissance barbare. C’est-à-dire si le consensus semble être assez large dans la population, peut-être pas parmi les économistes, sur l’idée de moins produire et de moins consommer, il est clair que la crise sanitaire montre ce qu’il ne faut pas faire, à savoir couper une jambe à tout le monde. C’est barbare ! C’est une dictature, on pourrait dire. Tout le monde est enfermé. Tel jour de l’année, on arrête complètement. Enfermé chez soi, dans un petit appartement, dans des quartiers populaires avec une famille nombreuse, ce n’est pas la même chose que d’être enfermé dans des grandes maisons, avec jardin. On voit bien ce qu’il ne faut pas faire.
Par contre, cela illustre le fait que quand on produit moins, la nature prend quelques libertés. Mais les choses ont repris leur cours très rapidement car on n’a pas pris le temps de questionner fondamentalement le sens et la signification des rapports de production. On a gardé les mêmes modes de production. On les a juste arrêtés. Puis on les a rallumés. En faisant cela, sans questionner la signification des rapports de production et les consommations sont restées les mêmes. Il aurait fallu profiter de cet arrêt pour se questionner sur ce modèle-là et peut-être ne pas rallumer les machines. Profitons de faire un inventaire productif des biens de consommation. On a écrit, avec les Atterrés un livre, De quoi avons-nous vraiment besoin ?, et on insiste beaucoup sur la relation entre mode de production et mode de consommation. Il ne s’agit pas de faire la transition en disant : « Il faut transformer notre mode de consommation et le système productif suivra ». Pas du tout ! Le système productif produit les demandes dont il a besoin. Il faut s’attaquer au rapport social de production, qui est le cœur du capitalisme. Le capitalisme est né avec le rapport de production fondé sur le productivisme et le salariat. C’est sa base. Le consumérisme a suivi tardivement. La société de consommation, c’est à partir des années 60. Bien après la naissance du capitalisme. C’est pour cela que pour bifurquer, il faut renverser ces modes sociaux de production fondés sur la soumission des salariés, la propriété privée abusive et la maitrise technologique du monde.
Propos recueillis par Jonathan BAUDOIN